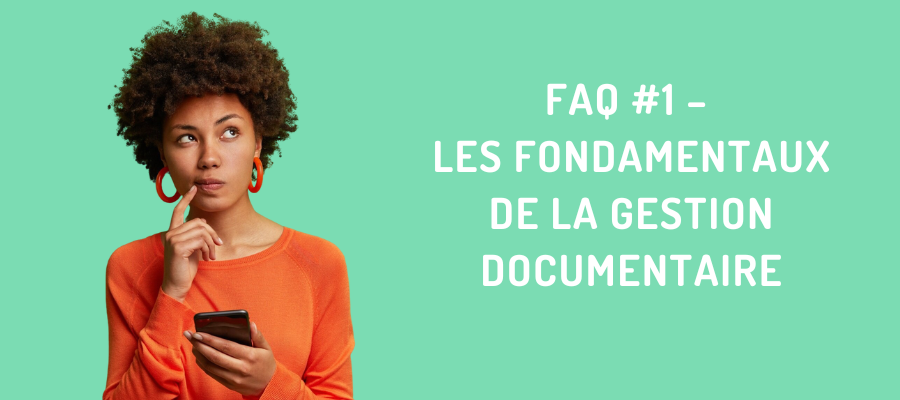FAQ #1 – 10 questions pour maîtriser les fondamentaux de la GED
Voici le premier volet d’une nouvelle série de FAQ qui paraîtra tous les trois mois dans notre newsletter. L’objectif ? Répondre de manière claire aux questions les plus fréquentes que vous nous posez et vous donner les clés pour orienter vos futurs projets de gestion documentaire. Pour commencer, voici dix principaux thèmes qui reviennent fréquemment dans nos échanges avec vous.
1. GED ou SAE : faut-il choisir entre gestion et archivage électronique ?
La GED (Gestion Électronique de Documents) pilote la création, la collaboration et la diffusion des documents tout au long de leur vie active ; le SAE (Système d’Archivage Électronique), lui, se concentre sur leur conservation intègre et probante à long terme. Concrètement : la GED optimise l’activité quotidienne et les workflows, tandis que le SAE garantit la conformité réglementaire et la pérennité des preuves. Les deux solutions n’ont donc pas du tout la même vocation et peuvent se compléter au sein d’une même architecture.
2. Souscription (SUBS) ou acquisition perpétuelle (PERP) : quel modèle économique adopter ?
La souscription répartit les coûts dans le temps, inclut la maintenance éditeur et offre une grande agilité pour ajuster le nombre d’utilisateurs. L’acquisition perpétuelle de son côté nécessite un investissement initial plus élevé, mais devient souvent rentable sur le long terme, surtout lorsque le nombre d’utilisateurs est stable et que l’infrastructure reste sur site. Le choix dépend donc de votre horizon budgétaire, de votre besoin de flexibilité et des contraintes d’hébergement de vos données.
3. Hébergement Cloud ou sur site : quel est le meilleur compromis ?
Un déploiement Cloud (SaaS ou IaaS) assure une mise à jour continue, une haute disponibilité et réduit la charge d’exploitation interne ; l’option “on-premise” offre un contrôle total sur l’infrastructure, répond à certaines exigences de souveraineté et peut optimiser les performances pour des volumes très importants. Le facteur clé réside dans la politique de sécurité et la connectivité de votre organisation.
4. Open Source ou logiciel propriétaire : comment arbitrer ?
Les solutions Open Source séduisent par l’absence de coûts de licence et la transparence du code ; elles requièrent toutefois des compétences internes ou un partenaire intégrateur solide pour l’implémentation et la maintenance. Les solutions propriétaires, elles, offrent des roadmaps produit connues, un support éditeur structuré et des certifications métier – mais s’accompagnent de licences payantes et d’une dépendance à l’éditeur. La décision doit prendre en compte la stratégie IT globale, la réversibilité souhaitée et le TCO (Total Cost of Ownership).
5. Maintenance éditeur et TMA : quel contrat pour faire vivre votre solution ?
La maintenance éditeur couvre la correction des bugs, les mises à jour et l’accès au support technique directement auprès de l’éditeur du logiciel. La Tierce Maintenance Applicative (TMA) va plus loin : un intégrateur externalise la maintenance corrective, évolutive et préventive, consacre une équipe dédiée à vos besoins et garantit la disponibilité applicative par SLA. Pour les SI complexes, la TMA permet de mutualiser les expertises et de concentrer vos ressources internes sur des projets à forte valeur ajoutée.
6. Licences concurrentes ou nommées : quel impact sur le budget ?
Une licence nommée est liée à un utilisateur précis ; elle assure un droit d’usage exclusif mais peut s’avérer coûteuse pour des équipes nombreuses. La licence concurrente autorise un nombre illimité de comptes mais limite le nombre d’utilisateurs connectés simultanément ; elle optimise les coûts quand les accès sont sporadiques ou répartis en équipes tournantes. Le calcul doit se baser sur votre pic de connexions quotidiennes plutôt que sur votre effectif total.
7. Quels sont les niveaux d’intégration possibles avec vos applications métier ?
On distingue généralement :
- Connecteurs natifs prêts à l’emploi (ERP, CRM, bureautique) ;
- API REST/SOAP exposées par l’ECM pour des intégrations point-à-point ;
- ESB / iPaaS qui orchestrent les échanges de données à l’échelle du SI ;
- Scripts ou RPA pour automatiser des tâches sans développement lourd.
Le niveau retenu dépend du volume d’échanges, des performances attendues et de la gouvernance des données.
8. LAD vs RAD : comment se répartissent les rôles de la capture intelligente ?
La RAD (Reconnaissance Automatique de Documents) identifie la nature du document (facture, contrat, pièce d’identité…) grâce à des modèles visuels ou à l’IA. La LAD (Lecture Automatique de Documents) extrait ensuite les informations clés (montants, dates, références) pour alimenter la GED ou le workflow. Les deux technologies fonctionnent souvent de concert : une RAD performante optimise la LAD. Notez que les générations récentes s’appuient sur l’IA pour accroître la précision et réduire le paramétrage manuel.
9. Workflow linéaire ou conditionnel : lequel choisir pour vos processus ?
Un workflow linéaire suit des étapes fixes et séquentielles (ex. : réception → validation → archivage) ; il est parfait pour des processus simples et reproductibles. Un workflow conditionnel, lui, ajuste dynamiquement le parcours du document en fonction de règles (montant d’engagement, service concerné, pays, etc.) ; il réduit les cycles de décision complexes et limite les goulots d’étranglement. En pratique, la plupart des projets combinent les deux : une trame linéaire complétée par des embranchements conditionnels.
10. Signature électronique à valeur probante ou tampon physique : quelles garanties ?
Le tampon physique apposé sur un document papier signale surtout un visa administratif. S’il peut attester l’identité d’un utilisateur, il n’atteste pas l’intégrité du contenu, et sa reproduction (photocopie, scan) n’a pas la même force que l’original. À l’inverse, la signature électronique avancée ou qualifiée repose sur un certificat nominatif émis par un Prestataire de Services de Confiance (PSCO) ; elle scelle cryptographiquement le document, horodate l’action et lie juridiquement le signataire au contenu. Résultat : une valeur probante équivalente à celle d’une signature manuscrite, conforme aux exigences réglementaires et opposable en justice. Ainsi, pour tous les actes engageants ou réglementés, la signature électronique s’impose là où le simple tampon reste insuffisant.
Rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine FAQ, où nous aborderons des thématiques plus spécifiques. En attendant, n’hésitez pas à nous poser vos questions par mail ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux :
- Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gd-expert
- Sur Twitter : https://twitter.com/GDExpert
- Sur Facebook : https://www.facebook.com/GlobalDocumentExpert/